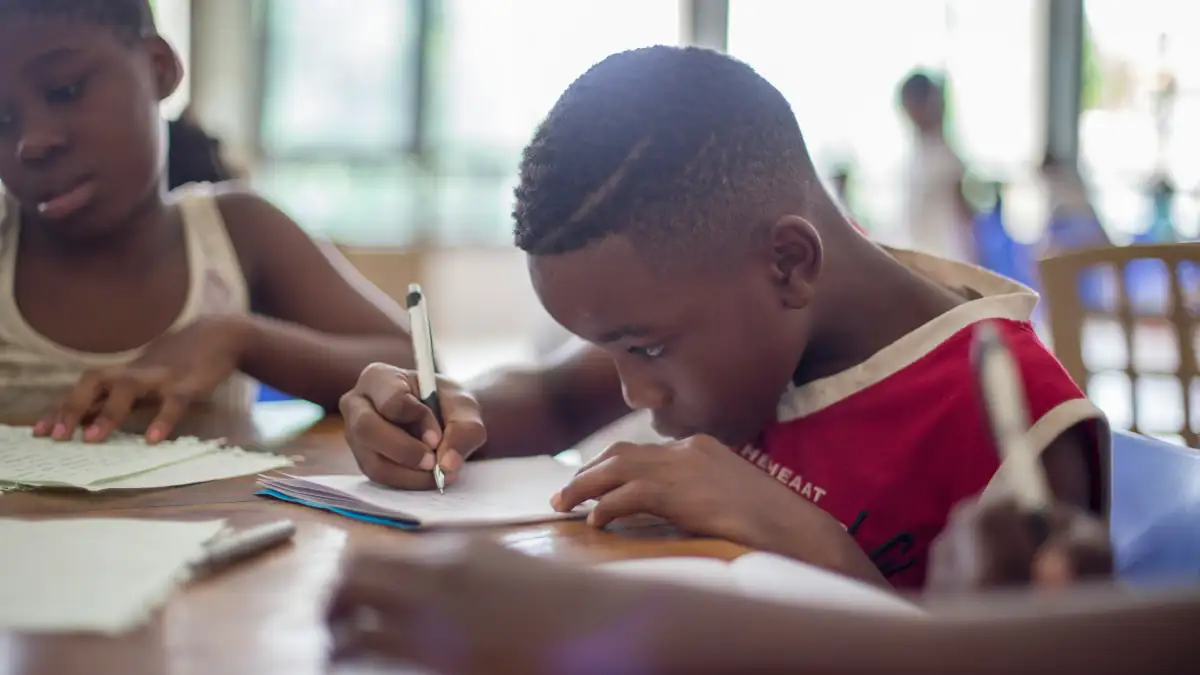L’ancienne militante du Black Liberation Army, réfugiée à Cuba depuis plusieurs décennies, est morte le 25 septembre à La Havane. Condamnée aux États-Unis pour le meurtre d’un policier en 1977, elle avait échappé à la prison après une spectaculaire évasion. Sa disparition relance le débat sur son héritage politique et sur les tensions historiques entre Washington et La Havane. Son parcours reste marqué par des liens familiaux notables, notamment avec le rappeur Tupac Shakur, assassiné en 1996.
Un décès qui clôt un long exil
Assata Shakur, née Joanne Chesimard à New York en 1947, est décédée le 25 septembre 2025 dans la capitale cubaine à l’âge de 78 ans, selon le ministère cubain des Affaires étrangères. Sa fille, Kakuya Shakur, a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Le communiqué officiel a évoqué des « problèmes de santé liés à l’âge ». Cette disparition met un terme à plus de quatre décennies d’exil qui avaient fait d’elle un symbole pour certains militants noirs américains et une fugitive recherchée par les autorités des États-Unis.
L’ancienne membre des Black Panthers et du Black Liberation Army s’était fait connaître au début des années 1970 pour son engagement dans la contestation raciale. Elle avait été condamnée en 1977 pour le meurtre d’un policier sur le New Jersey Turnpike, au terme d’un procès qu’elle et ses soutiens jugeaient partial. En 1979, elle s’était évadée de prison avec l’aide de militants armés et avait trouvé refuge à Cuba, qui lui avait accordé l’asile politique, refusant de l’extrader malgré les demandes répétées de Washington. Ces événements illustrent encore aujourd’hui la complexité des relations diplomatiques entre les deux pays.
Pendant son exil, Assata Shakur est restée une figure de référence pour certaines organisations de défense des droits civiques. Elle a longtemps été inscrite sur la liste des fugitifs les plus recherchés du FBI, qui avait offert une récompense d’un million de dollars pour sa capture. L’annonce de sa mort a suscité des hommages au sein de mouvements militants et de critiques de responsables américains qui rappellent son passé judiciaire. Les débats sur son héritage alimentent encore les discussions autour des luttes raciales aux États-Unis.
Un héritage marqué par la mémoire et la culture populaire
Le parcours de Shakur est également lié à la culture contemporaine américaine. Elle était la marraine et tante par alliance du rappeur Tupac Shakur, l’une des figures majeures du hip-hop, assassiné à Las Vegas en 1996. Cette parenté avait contribué à maintenir son nom dans l’espace public, notamment dans des chansons et des débats sur l’histoire des mouvements noirs américains. Pour de nombreux artistes et militants, cette filiation symbolise le lien entre les luttes politiques des années 1970 et l’expression culturelle urbaine des décennies suivantes.
Ce lien familial a aussi nourri l’attention médiatique autour d’elle à chaque nouvelle étape judiciaire ou diplomatique. Les demandes d’extradition formulées par Washington, restées sans suite, rappellent la persistance des différends entre les États-Unis et Cuba. La question du statut légal des réfugiés politiques sur l’île reste un point sensible dans les discussions bilatérales. Des spécialistes des relations internationales soulignent que ce dossier a souvent été instrumentalisé par les deux pays, à la fois sur le plan juridique et politique.
Aujourd’hui, l’annonce de sa disparition met un terme à des décennies de polémique et d’incertitude judiciaire. Elle laisse derrière elle une image contrastée : militante pour les uns, condamnée en fuite pour les autres. Son histoire demeure un sujet de recherche pour les historiens et continue d’influencer la mémoire collective des luttes pour l’égalité raciale aux États-Unis et au-delà.