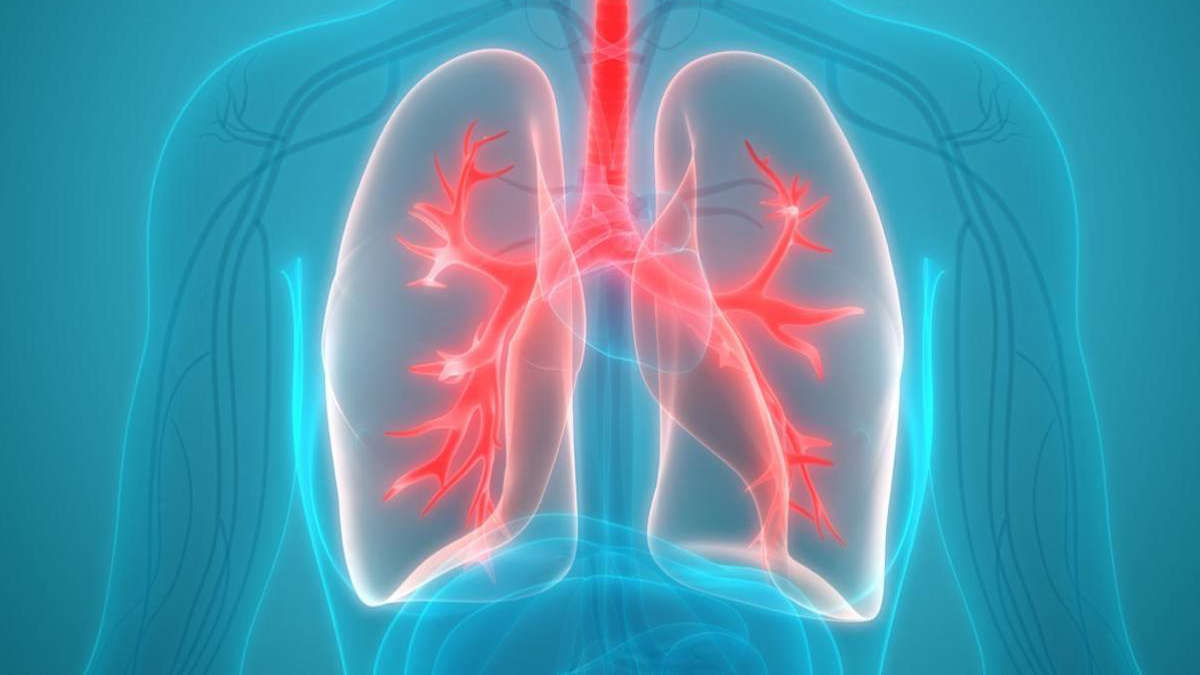
Dix-sept cas de légionellose ont été recensés récemment dans le secteur d’Albertville, en Savoie, selon les autorités sanitaires régionales. Parmi les personnes touchées, une est décédée et plusieurs autres ont dû être hospitalisées en réanimation. Cette situation attire l’attention sur une maladie encore relativement méconnue du grand public, bien qu’elle fasse l’objet d’une surveillance régulière par les services de santé. L’épisode en cours met en lumière la nécessité de mieux informer sur ses origines, ses symptômes et les moyens de prévention.
Une infection respiratoire d’origine environnementale
La légionellose est provoquée par une bactérie appelée Legionella, présente dans les milieux humides et les réseaux d’eau chaude. Elle se développe particulièrement dans les systèmes mal entretenus, comme certaines installations de climatisation, les tours de refroidissement ou encore les chauffe-eau collectifs. La contamination survient généralement par inhalation de fines gouttelettes d’eau contaminée. Contrairement à d’autres infections respiratoires, elle ne se transmet pas directement d’une personne à une autre, ce qui distingue cette maladie d’épidémies classiques comme la grippe ou la COVID-19.
La maladie peut prendre plusieurs formes. La plus bénigne, appelée fièvre de Pontiac, provoque une forte fièvre, des douleurs musculaires et une grande fatigue, avant de disparaître spontanément en quelques jours. La forme la plus sévère, en revanche, entraîne une pneumonie pouvant s’accompagner de toux persistante, de difficultés respiratoires, de douleurs thoraciques et de troubles digestifs. Cette forme grave peut évoluer rapidement et nécessite une prise en charge médicale urgente, particulièrement chez les personnes âgées, les fumeurs ou celles dont le système immunitaire est affaibli.
Le diagnostic repose sur des analyses biologiques, comme la recherche d’antigènes spécifiques dans les urines ou des cultures effectuées à partir d’échantillons respiratoires. Le traitement, quant à lui, repose sur une antibiothérapie ciblée, généralement administrée pendant une dizaine de jours, voire davantage en cas de complications.
Prévenir les risques grâce à l’entretien des installations
La prévention de la légionellose repose avant tout sur un contrôle rigoureux des installations à risque. Les réseaux d’eau chaude doivent être régulièrement vérifiés et entretenus, tout comme les systèmes de climatisation et les tours aéroréfrigérantes utilisés dans certains bâtiments collectifs. Une température suffisamment élevée de l’eau dans les chauffe-eau domestiques contribue également à limiter le développement de la bactérie.
Les autorités sanitaires insistent sur la nécessité de surveiller attentivement les établissements recevant du public, tels que les hôpitaux, les hôtels ou les piscines, où des contaminations collectives peuvent survenir. Les particuliers sont aussi invités à rester vigilants, notamment lorsqu’ils disposent d’installations peu utilisées où l’eau peut stagner.




